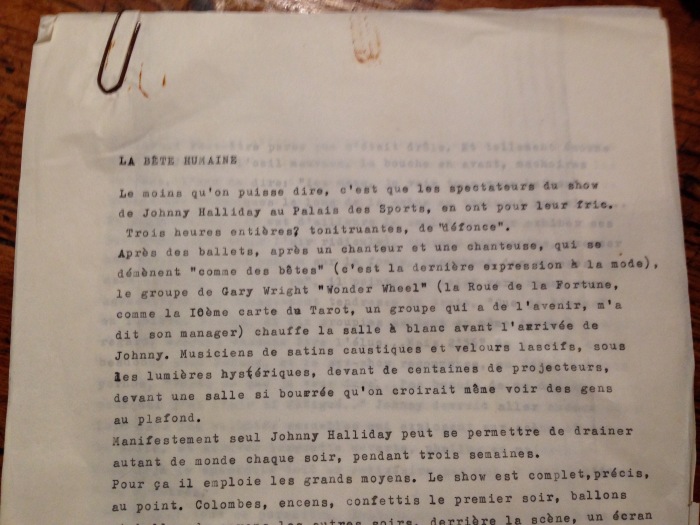Sur l’assassinat du Président Kennedy
Comment une jeune fille de 17 ans, préparant sa Composition d’Histoire-Géographie sur les Etats-Unis, a vécu en direct l’assassinat du Président Kennedy avec ses camarades d’internat au lycée Maurice Ravel de Paris, 20e, l’année du Baccalauréat de Philosophie.
Ce texte a été écrit le lundi 22 novembre 1965 le soir à 8 heures et les jours suivants, en souvenir des moments historiques qui ont changé la vie du monde, décrivant une prise de conscience universaliste, une initiation brutale vers l’âge adulte, un révélateur personnel.
Volontairement, ce billet de blog n’est pas illustré, il l’est par l’écriture.
***
Vendredi 22 novembre 1963
Il était 8 heures à l’internat, nous venions de sortir de table, nous rentrions dans nos chambres, j’étais dans celle de Monique et je lui faisais réciter le rôle des États-Unis dans la guerre de 14-18, assises l’une en face de l’autre sur son lit, le livre blanc et noir devant moi, elle parlait, je posais des questions, elle répondait, la douceur de la couverture bleue et blanche, l’unique lampe au-dessus de nous, la table, les livres partout, la grosse bougie, je sens encore l’atmosphère harmonieuse de cette chambre, j’étais bien. Monique était un peu tendue, le lendemain elle avait Composition d’Histoire et Géographie et elle avait bossé comme une folle pour réviser tout son programme du 1er trimestre, la guerre, l’histoire des USA jusqu’en 1940, toute la géographie économique des États-Unis. Elle me parlait de Wilson et de tous les présidents suivants.
Il était près de 8h30, nous étions sorties un instant dans le couloir, je ne sais plus pourquoi, pour chercher un bouquin dans ma chambre peut-être, la porte de Nicole s’ouvrait, elle sortait en chemise de nuit les cheveux mouillés :
— Kennedy a été blessé à Dallas !
Kennedy a été blessé à Dallas, répétait Nicole, Monique me regardait, je regardais Monique puis Nicole.
— C’est très grave.
Elle donnait des détails entendus à l’instant sur son transistor.
— Il était avec sa femme au Texas, on a tiré sur lui, il est blessé à la tête, c’est très grave.
Elle parlait vite, nous comprenions mal. Nous rentrions dans la chambre de Monique. Oui, Kennedy a été blessé. Mais il faut travailler, demain la Composition, la guerre, l’histoire des U.S.A., la géographie des États-Unis, l’économie du Texas, le pétrole, les présidents américains, de Woodrow Wilson jusqu’à Eisenhower, puis Kennedy, le dernier, les industries de Dallas, le Texas, Kennedy, Dallas, Texas, Dallas, Dallas, Dallas.
Nous essayions de travailler, Monique s’énervait, Kennedy je ne le connaissais pas vraiment, je savais qu’il existait, qu’il luttait pour la liberté des Noirs, mais que savais-je de plus, rien, Monique s’énervait, je m’inquiétais, Nicole encore et d’autres filles devant la porte :
— Kennedy est blessé, c’est très grave.
— Qu’est-ce qui va se passer ?
Mireille de Terre-Neuve toujours pessimiste avec son accent canadien français :
— Ça va être terrible, il va y avoir des histoires avec l’Union Soviétique et la Chine et le Vietnam et les Noirs, etc.
Monique s’énerve, je le sens et je ne sais que faire pour la calmer, elle sort, elle est tendue, elle crie :
— Mais c’est idiot de pleurer sur son sort, il n’est pas encore mort, ce n’est pas la peine de faire son oraison funèbre, il n’est pas encore mort, pas encore…
Oh ! Monique…
Elle rentre, elle n’en peut plus, elle va craquer, les autres entrent :
— On voit bien que tu es communiste !
— Non, je n’ai jamais été communiste, foutez-moi la paix !
Elle s’est assise sur le lit :
— Vas-y, pose-moi des questions !
Je pose les questions : les 14 points du président Woodrow Wilson, les présidents américains toujours. Que faire, Monique s’énerve, elle ne sait plus où elle en est, j’essaie d’être calme, mais je m’inquiète, Kennedy je ne le connaissais pas et déjà…
La porte s’ouvre :
— Il est mort ! Il est mort !
Ce cri nous est adressé comme un défi. Comme si Nicole et Mireille voulaient ainsi mettre Monique en accusation, tu vois tu disais que ce n’était pas la peine de pleurer mais il mort c’est bien fait pour toi…
Il est mort, comment travailler, comment apprendre toute cette histoire passée alors que l’histoire se fait à cet instant, que tout s’arrête, que tout va se décider.
La porte se referme mais je sors, j’essaie d’expliquer que Monique est très tendue et que son mot maladroit n’a rien à voir avec ses idées communistes. Monique je l’estime, je l’aime, elle et moi avons créé un climat à l’internat, nous travaillons, c’est beau, grand, jamais banal. Je rentre. Je reprends le livre, les présidents, Wilson et les autres, jusqu’à Kennedy et même lui fait partie de cette liste passée, passée… Nous ne parvenons pas à nous fixer à la page, Monique parle :
— Tu sais si tu veux partir, tu peux… moi je dois travailler, mais je réviserai seule.
J’hésite, je n’ai composition que lundi, même programme mais qui peut attendre… J’hésite à laisser Monique. Pourtant je suis inquiète. Je sors, les autres sont dans la chambre à côté, celle de Mireille, autour d’un transistor, les informations se succèdent, brèves et cinglantes, encore incertaines. Il y a là Mireille, Michelle, Éveline, Béa aussi avec son air toujours digne et posé, Joëlle, Alice, toutes parlent beaucoup, je ne comprends rien je ne connais rien. Lyndon Johnson, qui est-ce je n’ose pas demander, elles ont l’air tellement au courant, je suis si ignare, je finis par comprendre qu’il est le vice-président qu’est-ce que c’est, il doit remplacer le président en cas d’assassinat c’est le cas présent, et le frère du président qu’est-ce qu’il est, ministre de la justice, ah ! je ne savais pas, et comment il s’appelle, Robert, mais on l’appelle Bob ou Bobby, ah ! je n’en avais jamais entendu parler je ne connais rien je ne parle pas je n’ose pas poser de questions je prends brusquement conscience de mon ignorance je ne sais rien rien.
Mireille sait, elle parle :
— Je suis sûre que ça va agir sur le cours de la Bourse.
Dernier communiqué :
— On nous signale une très forte baisse à Wall Street !
Wall Street, tout ce que j’ai à apprendre, jamais je n’ai eu la moindre notion de ces problèmes, ça m’ennuyait, ça me fatiguait, ça n’avait pas de sens, je préférais la poésie, le théâtre, mes livres. Je me souviens du début du mois de novembre 1960, au moment de l’élection de Kennedy, toutes les filles de l’internat étaient folles de joie. Ah ! il est jeune, il est beau ! Je m’en fichais, tant mieux pour lui. Voyant mon indifférence, une fille m’avait dit :
— Mais enfin tu ne t’intéresses pas à la politique, comment peux-tu vivre ? C’est absolument dramatique.
J’avais répondu comme ça sans y penser :
— Oh ! moi ça m’est égal, je préfère la poésie, ça me suffit.
Elle était convaincue que je n’étais pas normale, peut-être avait-elle raison. Tout ce que j’ai à apprendre.
Oui, c’est tragique Kennedy est mort alors que je ne le connaissais pas, alors que je ne connais rien, mais comment ai-je pu vivre sans avoir conscience de ces problèmes, comment ai-je pu vivre sans rien savoir, je n’existais pas, je dois exister, brusquement cet événement est la seule chose qui compte, il écarte tous les petits problèmes, il prend toute la place, tous ces mots que je ne saisis pas encore me crient Kennedy est mort et tu ne le connaissais pas, c’est la seule chose qui compte, le reste n’a plus d’importance.
Les filles parlent, elles anticipent sur les conséquences probables de cet assassinat. Lyndon Johnson est Texan, il est du Sud. J’écoute, j’essaie de comprendre.
— Les Noirs, qu’est-ce qu’ils vont devenir ?
C’est moi qui viens de poser cette question naïve.
— Les Noirs comment vont-ils se défendre, oui, ça va être terrible.
Il est presque 10 heures du soir, c’est l’heure à laquelle nous devons nous coucher habituellement. Monique est venue nous rejoindre, elle n’en pouvait plus de rester seule, sans savoir, sans savoir quoi d’ailleurs, rien de plus, il est mort, c’est tout, on étouffe de ne pas savoir, d’être enfermées ici dans cet internat entre les murs alors que le monde doit vibrer. La pionne vient, elle n’ose pas nous demander d’éteindre nos lumières comme les autres soirs, comment aller se coucher comme d’habitude, quand tout s’est arrêté. Joëlle lui pose la question :
— D’après vous que va-t-il arriver ?
La pionne répond :
— Eh ! bien s’il s’en sort, il restera sans doute diminué…
On l’arrête brutalement avec hargne :
— Mais il est mort !
Elle ne dit rien, elle n’ose plus parler, comme si elle était fautive, elle sort bientôt, les filles parlent, le transistor aussi :
— Le Président est mort dans les bras de sa jeune femme…
Et les filles :
— C’est affreux, pauvre Jackie !
Et moi je pense : ce n’est pas l’essentiel, l’essentiel c’est tout ce que je ne connais pas, ce temps perdu à dormir. C’est facile cette image de la veuve recevant sur ses genoux le corps ensanglanté de son mari. Mais non, qu’est-ce que je dis, c’est atroce… Je ne saisis pas encore, j’ai trop de choses devant les yeux, Johnson, les Noirs, Khrouchtchev, Wall Street. Oh ! j’ai envie de vivre brusquement, de vivre enfin en grand.
***
23 novembre 1963
Le samedi froid, notre réveil glacé, il s’est passé quelque chose hier soir, quoi déjà, oui c’est vrai Kennedy n’est plus, on en parle oui bien sûr, c’est triste, on écoute la radio, les nouvelles se répètent, au fond on ne sait pas grand chose, on ne connaît pas réellement l’assassin, on a arrêté un certain Lee Harvey Oswald, âgé de 24 ans, qu’on accuse d’avoir aussi abattu un policier et qui est soi-disant marxiste, qui a été dans les Marines, qui a fait des voyages en U.R.S.S., mais est-ce lui ?
Nous écoutons, les cours ne commencent qu’à 9h30, nous ne pouvons travailler seules dans nos chambres individuelles, comme nous le faisons d’habitude, nous sommes réunies autour de ce poste qui diffuse de la Musique d’Église, les obsèques auront lieu dans deux jours, lundi à Washington, la famille Kennedy a refusé les fleurs. Le cercueil a voyagé de Dallas à Washington en avion et est exposé à la Maison-Blanche ; l’air est froid et gris, tout est feutré, étrange, arrêté, suspendu.
Nous devons nous rendre en classe. Au cours d’Anglais, Canac fait une sale réflexion sur Oswald mais de quoi est-elle sûre ? Devant moi Nicole et Anne, deux externes, se retournent :
— Tu sais ce qui s’est passé ?
C’est vrai elles s’imaginent que les internes sont de pauvres prisonnières survivant en dehors des limites du monde et du temps, elles n’ont pas tort d’ailleurs, mais ce matin nous savons toutes. Nicole toujours trop sensible philosophe sur la fragilité du bonheur :
— Pauvre Jacqueline Kennedy, elle avait tout pour être heureuse et en une seconde elle se voit tout arracher !
Moi qui dis :
— Ce n’est pas l’essentiel, c’est affreux pour elle, mais le monde que va-t-il devenir ?
Je viens de prendre conscience du monde, alors à moi les belles théories, sur la liberté entre autres, j’ai tant à apprendre, Madame Kennedy est si mince, si fragile à côté de tout ce que j’ai perdu, elle n’a pas d’importance.
Les cours du matin et toujours cette idée : il s’est passé quelque chose de grave, tout s’est arrêté. À 13 heures, les actualités télévisées : Oswald nie, sa tête amochée sous les coups, il me fait mal, il semble irresponsable, désespéré, vulnérable. Un monsieur très sûr de lui parle de Bobby Kennedy, qui est-ce déjà ? ah ! le ministre de la justice, en américain ça se dit attorney general : Bobby pourrait-il remplacer son frère, on ne sait pas, les élections auront lieu dans un an et d’ici là les américains auront le temps d’oublier.
Lyndon Johnson à la télé, près de sa femme, c’est lui qui parle maintenant, ce n’est plus Kennedy.
Et nous voyons brusquement Madame Kennedy à côté de Lyndon Johnson qui prête serment dans l’avion.
L’avion arrive à Washington, à l’aéroport d’Andrews, le cercueil est descendu, Madame Kennedy s’avance, mince et fragile c’est vrai, vacillante, un homme l’aide à descendre, qui est-ce, son beau-frère, qu’il est jeune, c’est très rapide, elle s’avance très droite près de lui, son tailleur est tâché, le sang le sang sur son tailleur clair, rose nous dit-on sur la télé en noir et blanc, le sang sur ses bas, le sang de son mari, ses cheveux sombres encadrent son visage fermé immobile, elle s’avance droite vers une ambulance, Bobby la suit de près, elle se penche vers la portière, essaie d’ouvrir, c’est trop difficile, sa main retombe, Robert ouvre et l’aide à s’asseoir.
Je suis émue, je ne connaissais pas Madame Kennedy, elle est belle, très belle. Robert est jeune. Mais à qui me fait-il penser, pourquoi ai-je l’impression de le connaître, de l’aimer même, je ne sais pas, il me fascine, il me semble l’avoir toujours connu. Tout est rapide, quelqu’un parle encore de Oswald, c’est fini, il nous faut retourner au cours.
Monique a sa Composition maintenant. Cours d’Histoire et Géographie, nous devons encore étudier l’histoire des États-Unis entre les deux guerres et son économie. Le prof parle de Kennedy, du système constitutionnel américain. J’écoute. J’ai tout à apprendre. J’entends. Je me rappelle. Mais le sang sur le tailleur rose, le visage égaré de Robert, fragile comme un enfant, je ne peux pas penser, il me rappelle encore quelqu’un.
Monique vient de terminer sa Composition, en Géographie, grand sujet : le Sud des États-Unis, oui, c’était à prévoir, sujet dramatique, la chaleur de l’été indien, la condition des Noirs, les extrémistes de droite, les magnats du pétrole, à Dallas… Comment oublier, comment penser à autre chose…
Monique est fatiguée, elle en a assez, elle veut se changer les idées, elle rentre chez elle. Je reste ici, pour travailler pendant le week-end, à l’histoire et à l’économie U.S., je reste dans sa chambre, chaude et douce, dehors il fait froid, il neige presque, lentement, sans bruit, d’ailleurs tout s’est arrêté, j’étouffe, il est difficile de travailler, j’attends, je veux savoir, mais quoi.
J’écoute la radio après le dîner, je remonte vite : les actualités de 8 heures à la télévision dans la salle commune, le film rapide de l’assassinat, les réactions des spectateurs à Dallas, cette jeune fille qui se détourne en pleurant, l’agitation. Retour sur l’arrivée du Président et de Madame Kennedy à Dallas, l’avion, elle descend la première, élégante, une toque posée à l’arrière de ses cheveux noirs, elle sourit, le Président derrière elle, au pied de la passerelle une foule de personnalités, elle commence à serrer des mains, une femme s’avance et lui offre un immense bouquet de fleurs, elle remercie, sourit toujours, ses mains gantées de blanc enserrent les roses, son mari près d’elle, le cortège ensuite. Puis, brutal, l’assassinat, rapide, on ne voit plus rien, les flics sortent leurs armes, les gens se couchent pour échapper aux balles, ils doivent crier, on ne comprend plus rien, on voudrait crier aussi…
Et je rentre dans ma chambre, pleine de ces images violentes, choquantes, soudain je suis lourde de cet assassinat, je ne peux pas croire encore, mais c’est là en moi, à jamais…
***
24 novembre 1963
Le réveil de ce dimanche au matin brumeux et froid et clair. Les longues heures tendues rythmées par les nouvelles successives, le cercueil exposé à la Maison-Blanche, le programme de musique consacré à Bach ou autres compositeurs de musique d’Église ; les longues heures glacées et impalpables, étranges et feutrées, nous essayons de travailler, apprendre la Floride, la Californie et le Texas, revoir les présidents américains depuis Wilson, apprendre, travailler, mais quelque chose s’est cassé, le monde n’est plus pareil, plus comme avant. La télé après le déjeuner, le cercueil est transporté de l’aéroport à la Maison-Blanche, lentement accompagné des tambours voilés, comme tout est grave et doux, si lent, pas de bruit, on n’ose respirer, Mme Kennedy doit être à l’intérieur de cette voiture, puis travailler encore, essayer d’apprendre, oui il le faut, tout reste à faire.
Le soir, drame, coup de théâtre, Lee Harvey Oswald a été assassiné dans la prison, la barbarie n’a plus de limite, jusqu’où aller, tout semble si incertain depuis deux jours, tout est précaire, sapé, tout s’écroule, où en sommes-nous, assassinat de l’assassin présumé, comment croire en ce qui arrive ?
Le soir, le travail, la radio, le programme consacré à l’audition des œuvres aimées de Kennedy, j’entends la Musique du Grand Canyon que j’aimais tant enfant à Lorient, Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald… les nouvelles, le cercueil est transporté au Capitole, où il est exposé sous la Coupole pour le public.
Il faut travailler ici à Paris, mais je suis à Washington, je vis au rythme des tambours.
***
25 novembre 1963
Le lundi matin, les filles qui sont sorties pendant le week-end rapportent des journaux : la photo de Jack Ruby tirant à bout portant sur Lee Oswald, j’ai voulu venger Jacqueline, Madame Kennedy debout près de ses enfants blonds, droite et grande pendant la cérémonie au Capitole, puis une autre où on la voit agenouillée devant le cercueil avec son beau-frère Robert.
Puis au cours de Philo, Catherine Le M. m’apporte le New York Herald Tribune, beaucoup de photos, rétrospective sur la vie du Président. Chevroton, notre prof, anticipe aussi sur la fatalité, la destruction du bonheur, Madame Kennedy vous étiez si heureuse, elle parle de la mort de Camus révoltante aussi mais plus compréhensible car Albert Camus n’était pas heureux avec sa femme, qu’en savait-elle Chevroton, elle n’épargne pas la pauvre Francine, que depuis j’ai rencontrée au théâtre dans les coulisses à une séance de Caligula, femme si douce si aimante si passionnée des œuvres de son mari, je reste interloquée devant cette façon de voir les choses pour un prof de philo.
Les actualités encore, je ne les regardais jamais avant, que se passe-t-il en moi, savoir, savoir, les images de Washington, le cercueil, c’est la première fois que nous le voyons, porté par des soldats, recouvert du drapeau américain, à l’entrée de la Maison-Blanche, sous le péristyle, les présidents Eisenhower et Truman, le président de la bombe H, il n’est pas mort lui, le cercueil porté par les pas lents des soldats, descendu marche après marche, Madame Kennedy apparaît, si grande, si belle, si digne, elle donne la main à ses enfants jeunes et blonds, vêtus de manteaux clairs,
Madame Kennedy vous étiez belle, derrière vous votre beau-frère, accablé, vous restiez droite, la tête haute, vous regardiez le drapeau étoilé, qui descendait à pas lents, le cercueil était déposé sur la prolonge d’artillerie, les chevaux, vous restiez immobile, la sonnerie aux morts, vous ne bougiez pas, le bruissement métallique des sabres dans l’air froid, les chevaux se mettaient en marche, tirant la prolonge d’artillerie, vous restiez là toujours droite, des voitures noires s’avançaient, la première s’arrêtait au bas des marches, vous descendiez, tenant par la main Caroline et John-John, Robert Kennedy derrière vous, vous faisiez asseoir vos enfants dans la voiture, vous étiez belle Madame Kennedy,
Pennsylvania Avenue, immense et longue, noble en ce matin du dimanche 24 novembre, le cortège lent, les chevaux, les soldats, les voitures, jusqu’au Capitole, où le cercueil allait être exposé au public…
L’après-midi cours de français, Monsieur Petibon parle aussi de l’assassinat, de la lettre choquante adressée par Madame Nhu (Première Dame du Sud-Vietnam de 1955 à 1963, NdA) à Madame Kennedy, puis il critique les Anglais, curieuse façon encore de faire l’éloge d’un peuple en dénigrant l’autre, il ne cesse de proclamer son amour des U.S.A. et sa haine du Royaume Uni. Décidément beaucoup de choses m’échappent chez les adultes qui savent.
Et puis composition d’Histoire et Géographie, je l’avais un peu oubliée, elle ne me semble pas importante. Sujet : le Texas, oui, bien sûr, le Texas, comment s’en sortir, je travaille, mais sans cesse mon esprit dépasse ma feuille de papier, les mots que j’écris, je suis loin, j’attends, bientôt Kennedy sera enterré, bientôt tout sera fini, avant même que je n’ai commencé de vivre…
Il est presque 6 heures de l’après-midi à Paris, il est presque 11 heures du matin à Washington. Le cercueil a été transporté du Capitole à la Maison-Blanche, car le Président doit se rendre au cimetière à partir de la Maison-Blanche, nous attendons, la télévision doit retransmettre en direct par satellite le film des obsèques, la salle de télé est pleine, je suis assise par terre, juste devant, près de moi Monique, 6 heures à Paris, 11 heures du matin à Washington, l’émission du satellite Relay commence en Mondovision, Jacques Sallebert parle, sa voix est feutrée, la foule au long des rues, il doit faire froid, les arbres fins et nus, frileux, le cortège est arrêté devant la Maison-Blanche, la foule, un bataillon de soldats irlandais, leurs cornemuses, des soldats des grandes écoles militaires, dont West Point sans doute, des chevaux, la foule, le cercueil là soudain tiré par la prolonge d’artillerie, derrière, Black Jack, le cheval noir piaffant, presque rétif, guidé par un soldat, le sabre et les bottes du Président fixés à la selle, à l’envers en signe de mort, un marin suit portant le drapeau américain étoilé, puis juste derrière vient Madame Kennedy encadrée de ses deux beaux-frères, derrière eux les autres membres de la famille Kennedy, le cortège s’ébranle, Madame Kennedy marche, le cortège s’arrête un instant, elle est grande et droite, son beau visage voilé de noir, elle se tient immobile, en tailleur noir, strict, sobre, avec de longs gants noirs, elle est grande, bras le long du corps, près d’elle à sa droite Robert Kennedy, je crois le connaître, il m’est familier, Madame Kennedy la tête haute, derrière elle la foule, elle ne la voit pas, elle regarde droit devant elle, la foule, une femme noire éclate en sanglots, le cortège s’ébranle, Madame Kennedy marche, près d’elle Robert, elle marche fièrement d’un pas noble, le talon en attaque.
Madame Kennedy vous étiez belle, une fois vous avez failli trébucher, Robert Kennedy vous a pris la main et vous avez continué la tête haute, sans faiblir.
Le drapeau américain sur le caisson tiré par les chevaux, je ne peux pas y croire, John Fitzgerald Kennedy est mort, il est là dans ce cercueil recouvert du drapeau de son pays, c’est pour lui que marche cette jeune femme dramatiquement belle, c’est pour lui que piaffe ce cheval noir, son cheval, pour lui, pour lui, Madame Kennedy marche et derrière elle, s’ébranle en rangs désordonnés l’immense foule des chefs d’état, des rois, des princes, des ministres, des présidents, dont notre De Gaulle, le plus grand, tous sont venus à Washington assister aux obsèques du Président Kennedy.
Le cercueil, les chevaux, le cheval noir seul, le drapeau étoilé du Président, Madame Kennedy vous étiez belle, vous marchiez sans faiblir, votre voile antique plaqué par le vent sur votre visage tiré, vous étiez si grande que nous ne voyions que vous, vous donniez parfois la main à Robert Kennedy, égaré, un peu voûté, la tête rentrée dans les épaules, tout se fait sans lui, il se laisse porter, il ne sait pas très bien où il est, il marche, je le connais depuis longtemps déjà, pourtant je ne l’avais jamais vu avant, qui est-il, je l’aime profondément, sans savoir, l’air est froid mais pur, le soleil suit la marche si grande de cette jeune femme si belle, Madame Kennedy vous étiez belle, je vous ai admirée follement, vous marchiez jusqu’au bout, droite, la prolonge d’artillerie s’arrêtait au pied des marches de la cathédrale Saint Matthews, vous vous arrêtiez, immobile en face du caisson drapé de la bannière étoilée, vous étiez là, grande sur la première marche, toujours près de vous Robert et Edward Kennedy. Le cortège s’arrêtait car vous vous arrêtiez. Vous vous détachiez, vous faisiez quelques pas vers une voiture et lentement vous reveniez vers vos beaux-frères, voilée de noir, sublime, vous reveniez en serrant contre vous vos enfants blonds, vous vous arrêtiez au pied des marches, encadrée de Caroline et John-John, vous restiez là, immobile, et moi je pleurais, vous étiez belle, je pleurais, je ne voyais rien, vous seule près de ces enfants sans père, vous seule Madame, je pleurais.
Monique se tournait vers moi sans comprendre, mais oui je pleure, je sais c’est ridicule hier encore je disais que ce n’était pas l’essentiel mais maintenant je pleure pour cette image tragique au-delà de l’imaginable. Le caisson et le drapeau étoilé, derrière Madame Kennedy, ses enfants, Robert Kennedy, je pleurais, vous étiez belle Madame, vous montiez les marches de la cathédrale, je pleurais, c’était fini, je pleurais, nous sortions de la salle, je ne voyais rien. Je montais, je n’y croyais pas encore, non ce n’est pas pour Kennedy que tout ça a eu lieu, ce n’est pas possible. Je ne le connaissais pas, Madame Kennedy non plus.
Dans le couloir, Joëlle parlait en souriant à demi de la Sainte Famille, je ne comprenais pas ce qu’elle voulait dire, Monique non plus. Nous rentrions dans sa chambre, dehors il faisait nuit, je passais ma main sur la vitre glacée, je ne parlais pas, Monique non plus, je balbutiais, ce n’est pas possible, je sortais, Monique ne me retenait pas, je rentrais dans ma chambre.
Là, j’ai pleuré, la tête appuyée contre ma table de travail, le livre d’Histoire, une photo de Kennedy avec sa femme, prise je crois lors du baptême de John-John, en novembre 1960, je pleurais sans savoir, sans comprendre, je pleurais sur le temps perdu, je pleurais.
Madame Kennedy vous étiez belle…
***
C’est à mon père jeune, que ressemblait Robert Kennedy, avec ses yeux bleus d’Irlande, bleus de Mer, je le vérifierai plus tard sur les photos familiales.
***
Repérages :
Lieux :
Chambres individuelles de l’internat du lycée Maurice Ravel
Salles de classe du lycée Maurice Ravel
Salle de télévision de l’internat
Villes :
Dallas, Washington, Paris
Camarades d’internat et de classe :
Monique Demarle, Mireille (de Terre-Neuve), Michelle, Evelyne, Joëlle, Alice, Béatrice Nhan, Catherine le Moal, Nicole Leyne, Anne.
Professeurs de la classe de Philosophie :
Monsieur Petitbon : français, Madame Chevroton : philosophie, Madame Canac, anglais
Personnalités citées :
Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady, John Fitzgerald Kennedy, Président assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, Texas, U.S.A., Bobby Kennedy, frère du Président, Attorney General (Ministre de la Justice), Lyndon Johnson, Vice-Président, devenu Président, ce jour du 22 novembre 1963, Caroline Kennedy, presque 6 ans, John-John Kennedy, presque 3 ans, Lee Harvey Oswald, assassin présumé, abattu deux jours plus tard, Francine Camus, épouse de l’écrivain Albert Camus, Mahalia Jackson et Ella Fitzgerald, chanteuses de Negro-Spirituals, Ike Eisenhower et Harry Truman, les anciens Présidents, Madame Nhu, Première Dame du Vietnam, Jacques Sallebert, journaliste en poste à Washington, en liaison avec Paris par Mondiovision, Général De Gaulle, Président français.
Technologie :
Radio portative à transistors, dite Transistor
Télévision en noir et blanc
Satellite Relay reliant Washington à Paris en Mondovision
Black Jack, le cheval noir du Président Kennedy, portant les bottes et le sabre à l’envers, en signe de mort au combat.
***
Texte disponible dans le cahier des débuts : Au Loin un Phare, 1960-65.
Copyright by Gaelle Kermen – 2013
ACD Carpe Diem, éditrice Marie-Hélène Le Doze